Je me sens différent·e : quand mon ressenti m’isole…
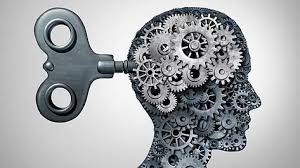 « Je me sens différent.e… », « je ne suis pas normal.e »/ «ce n’est pas normal », «je suis trop… », « les autres y arrivent… » etc.
« Je me sens différent.e… », « je ne suis pas normal.e »/ «ce n’est pas normal », «je suis trop… », « les autres y arrivent… » etc.
Des phrases que j’entends souvent en séance, constatée avec gêne, avec douleur.
Ce sentiment d’être « à part », « décalé·e », « anormal·e » peut générer incompréhension, isolement mais souvent, une grande souffrance.
1. Être différent·e, de quoi parle-t-on ?
• Différent.e de qui ? De quoi ? De la norme sociale ? Des « autres » (lesquels ?)
• Peut on vraiment parler d’un sentiment subjectif ou d’une réalité objectivable (neuroatypie, TCA, troubles psy, histoire de vie) ?
• Et cette «différence » est-elle visible (origine, genre, handicap) ou invisible (anxiété, trauma, hypersensibilité, HPI, TSA…) ?
• Alors « cette différence », on en fait quoi ?
2. Le poids de la norme et de la comparaison
Si j’ai tendance à me comparer à une forme de normalité, il est important de redéfinir ensemble ce que cela siginifie.
Une norme sociale est une règle implicite ou explicite qui définit ce qui est attendu, accepté ou valorisé dans un groupe ou une société donnée.
Elle oriente nos comportements, nos attitudes, nos manières de penser et même nos émotions.
Elle a aussi pour fonction de fédérer un groupe donné (et permettre de vivre ensemble selon des codes communs et un langage partagé).
Se saluer est une norme sociale. Saluer une personne que je n’aime pas peut être difficile pour moi mais je le fais pour être en lien avec le reste du groupe social auquel j’appartiens.
La norme sociale peut devenir un cadre rigide et excluant.
Des injonctions sociales (règles implicites) comme réussir (avec ses preuves), être sociable, « bien dans sa peau » impactent la santé mentale et son ressenti général.
Les critères sous-jacents à ces normes vont devenir, de façon non conscientisée notre étalon.
Je vais ainsi « mesurer » ma vie, mes actes, mes réactions, mes réussites etc. selon ce référentiel. C’est donc là que je peux me sentir différent.e.
Les réseaux sociaux ont aussi cet « effet détonateur » avec cette comparaison constante. Ce que l’autre me donne à voir devient ce qu’il faut / aurait fallu être/faire/atteindre…
2. Ma différence : un sentiment subjectif ou une réalité objectivable ?
 Nous venons de le voir : se ressentir différent.e relève de sa propre subjectivité tout en se comparant à des systèmes et modèles sociaux.
Nous venons de le voir : se ressentir différent.e relève de sa propre subjectivité tout en se comparant à des systèmes et modèles sociaux.
Certes ces derniers n’ont rien de rationnel ou scientifiques mais ils peuvent néanmoins devenir des faits bien réels.
Les normes, les modèles valorisés sont tout autant de réalités objectivables auxquels tous les individus d’un groupe ont à se confronter et, le plus souvent à adhérer pour s’intégrer.
Parallèlement, il existe des différences mesurables et reconnues en psychologie et en neurosciences.
Ces spécificités relèvent souvent des troubles du neurodéveloppement (TND) ou d’autres profils dits neuroatypiques.
Principales catégories de neuroatypies
(Nous les résumerons ici mais chacune peut être développée via les liens fournis)
Troubles du spectre de l’autisme (TSA)
• Difficultés dans la communication sociale, rigidités comportementales, particularités sensorielles.
• Variabilité très large : d’un soutien quotidien important à une autonomie complète.
• Différences hommes/femmes : diagnostics plus tardifs et plus subtils chez les filles (camouflage social, symptômes internalisés).
Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)
• Inattention, impulsivité, hyperactivité.
• Peut entraîner des difficultés scolaires, professionnelles ou relationnelles, mais aussi une forte créativité et réactivité.
Troubles des apprentissages (dys-)
• Dyslexie : difficultés spécifiques de lecture/écriture.
• Dyscalculie : difficultés liées aux nombres et au calcul.
• Dysorthographie, dyspraxie, dysphasie, etc.
• Souvent masqués par des stratégies de compensation, mais générant fatigue et sentiment d’écart.
Haut potentiel intellectuel (HPI) / douance
• Quotient intellectuel significativement supérieur à la moyenne.
• Peut s’accompagner d’une hypersensibilité, d’un sentiment de décalage ou d’isolement social.
• Parfois associé à un risque accru d’anxiété ou de troubles de l’humeur.
Autres profils associés à la neurodiversité
• Hypersensibilité sensorielle : perception exacerbée des sons, lumières, textures.
• Troubles anxieux ou affectifs liés à la régulation émotionnelle atypique.
• Variabilité de genre et identité plus fréquente dans certains profils TSA.
Outils d’évaluation et de repérage (à faire auprès de professionelles comme les neuropsychologues)
• Tests psychométriques : WAIS (intelligence), WISC (enfants/adolescents).
• Échelles spécifiques :
◦ ADOS-2, ADI-R (autisme),
◦ Conners, Brown ADD (TDAH),
◦ batteries neuropsychologiques pour les « dys ».
• Questionnaires cliniques : auto-questionnaires (AQ, RAADS-R pour l’autisme, DIVA-5 pour le TDAH), toujours à confirmer par un entretien clinique.
• Observations et bilans pluridisciplinaires : psychologue, orthophoniste, ergothérapeute, psychiatre.
3. Quand la différence devient source de souffrance
Différences, légitimité et isolement
Le ressenti puis la conviction d’être différent.e vient ainsi de toutes ces influences des autres et ce que je déduis de ce qui se vit chez autrui.
Par conséquent, je vais avoir des difficultés à me sentir légitime, compris.e, accepté.e.
En présence des autres mais aussi, seul.e face à moi-même, je vais alimenter cette impression de différence. Je vais me comparer à ce que les autres vivent, le plus souvent par des effets d’interprétations.
Pire, nous allons développer un biais de confirmation qui va aussi enrichir ma croyance première.
De fait, quand j’écouterai les autres, je les trouverai « plus à l’aise », « plus heureux », «réussissant facilement » etc.
Le plus souvent, on nourrit aussi le sentiment d’isolement, avec un effet naturel d’association « entre ces autres qui se comprennent » et soi-même qui est exclu.e.
Différences, anxiété, repli et infériorité
 Le constat est sans appel : mes patient.e.s « différent.e.s » souffrent à la fois de cette image de soi mais c’est cette même image d’eux et d’elles-mêmes qui entament leur estime, développent une forte anxiété et un complexe d’infériorité.
Le constat est sans appel : mes patient.e.s « différent.e.s » souffrent à la fois de cette image de soi mais c’est cette même image d’eux et d’elles-mêmes qui entament leur estime, développent une forte anxiété et un complexe d’infériorité.
Les autres deviennent « modèle » de bonheur.
Or, en ne pouvant ressembler aux autres, pas d’accès au bonheur.
Prophétie auto-réalisatrice, cercle vicieux dans lequel on est enfermé.e ?
Les 2 fonctionnent. Cette auto-suggestion permanente renforce ma croyance négative de cette différence.
Cela va particulièrement augmenter mon taux d’anxiété.
Nous sommes des êtres sociaux partageant un espace social dans lequel chacun.e évolue.
A force de me considérer en dehors de cette norme sociale attendue et valorisée, toutes mes interactions seront teintées de la peur d’être non-aimé.e, rejeté.e voire être associé.e à de l’imposture.
Différences, sur-adaptation et épuisement psychique
Beaucoup de personnes qui se sentent « différentes » développent des stratégies de sur-adaptation.
Comme nous l’avons expliqué au sujet des « normes », elles s’efforcent de répondre aux attentes implicites de la société ou de leur entourage, parfois au détriment de leur authenticité.
Elles observent, imitent, se contraignent pour paraître « comme les autres » au prix de leur propre bien-être.
La sur-adaptation peut donner l’illusion d’une bonne intégration sociale, mais elle s’accompagne souvent :
• d’une fatigue psychique et physique liée à l’effort permanent,
• d’une perte de repères identitaires (« qui suis-je vraiment si je joue un rôle ? », syndrome de l’imposteur etc.),
• d’un risque d’anxiété, de dépression ou de burnout.
Chez les personnes neuroatypiques, et notamment chez les femmes autistes, ce phénomène est très fréquent.
Le camouflage social (ou masking) permet de se protéger du rejet, mais renforce l’invisibilité diagnostique et la souffrance silencieuse.
4. Et si être différent·e n’était pas un problème ?
L’accompagnement psychologique comme espace d’exploration et de réparation.
Ces différences ne définissent pas une identité entière, mais éclairent certains fonctionnements.
Grâce à la réflexion amorcée en psychothérapie, on va apprendre à se rencontrer puis se connaître. Cette appréhension de soi-même, ses spécificités, ses « différences » justement vont faciliter l’acceptation de soi.
 En valorisant l’individualité, on redevient sujet de sa propre vie.
En valorisant l’individualité, on redevient sujet de sa propre vie.
La psychologie est aussi là pour rappeler combien la diversité de nos histoires font de nous des personnes à part entières, toutes uniques les unes par rapport aux autres.
Chaque chemin de vie est singulier et chaque personnalité se construit entre forces et faiblesses. Aucun modèle unique n’est recherché. Pas plus qu’une pensée unique qui limite le monde et ses évolutions.
C’est justement la force des différences qui fait bouger, se transformer et grandir une personne et toute une humanité.
« C’est dans ce que les hommes ont de plus commun qu’ils se différencient le plus » écrit Blaise Cendrars.
Le diagnostic peut aider à mettre du sens, accéder à des accompagnements adaptés (aménagements scolaires, reconnaissance handicap, psychothérapie ciblée). Il n’a néanmoins aucune visée normative ni jugeante.
Au contraire, en valorisant ses différences pour mieux se les approprier, le travail thérapeutique permet l’apaisement envers soi-même.
Si se sentir différent·e, c’est ressentir un écart (douloureux) entre soi et le monde, c’est aussi une invitation à se (re)trouver, à se relier aux autres autrement, et à construire une vie à son image.
La psychothérapie sert aussi à faire de ses différences des forces, des ressources pleines et entières pour vivre une vie qui nous ressemble sans validation d’autrui, sans besoin de légitimité.
Être soi, comme on est. Tout simplement.





